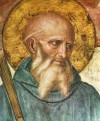(Illustration : la Cène, bas-relief du XVIème siècle – Eglise St-Potentien de Chatel-Censoir)
Chatel-Censoir, à l’entrée du Morvan sur le haut cours de l’Yonne, est aujourd’hui un bourg modeste, mais tout y respire une haute antiquité. Aux limites orientales du Donziais, elle relevait de l’ancien diocèse d’Autun – qui comprenait la région d’Avallon – mais appartenait aux évêques d’Auxerre, par un de ces mystères dont l’histoire féodale a le secret.
Ce castrum éduen a été une importante place gallo-romaine, comme l’ancienneté des fortifications à leurs bases et de nombreuses trouvailles archéologiques dans toute la région en attestent. Saint Pèlerin, le grand évêque d’Auxerre, en fut l’évangélisateur, mais c’est le martyr d’Entrains, Saint Potentien, deuxième évêque de Sens, qui a donné son nom à la Collégiale.
Il semble que la ville tienne son nom de Censure, évêque d’Auxerre au Vème siècle, – correspondant de Sidoine Appolinaire – dont la famille tenait une grande partie de la région, et qui en fit don à son diocèse à l’instar de son illustre prédécesseur le grand Saint Germain.
______________
La possession seigneuriale de Chatel-Censoir est à associer entièrement à celle de Donzy, depuis Warin de Vergy, comte de Mâcon et de Chalon au IXème siècle, ancêtre des barons de Semur et de Donzy. Cette communauté de destin donne à Chatel-Censoir un statut unique en Donziais. Sur le plan géographique, elle contribue à former la longue bande de la Loire à l’Yonne qu’a été cette baronnie. Chatel-Censoir en devint logiquement une « châtellenie » lorsqu’elle se structura.
La place a toutefois été disputée pendant plusieurs décennies aux barons par les comtes originels de Nevers, mais cette querelle s’est trouvée sans objet à la réunion de ces deux grands fiefs, par l’alliance de Mahaut de Courtenay avec Hervé de Donzy. Dès lors le destin de Chatel fut celui du Nivernais dans son ensemble.
Un château baronnial dominait la forteresse de Chatel-Censoir, et les barons, puis les comtes de Nevers y nommaient des « châtelains » pour les représenter.
Deux lignées, peut-être réunies, ont marqué la cité aux XIème et XIIème siècles : les Wibert et les Ascelin, qui se sont taillés des fiefs importants dans la région (voir notice Merry), où ils s’implantèrent définitivement. Un Gymon de La Rivière, de la grande famille nivernaise de ce nom, conseiller de Geoffroy IV de Donzy, vint exercer cette fonction, ou encore Jean de Fretoy vers 1400.
La gentilhommière qui subsiste de nos jours en haut de la colline, est l’héritière des anciens châteaux forts dans ce site, dont des traces subistent (murs, tour…) mais dont on n’a pas d’image ancienne.