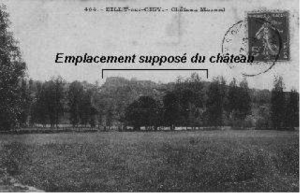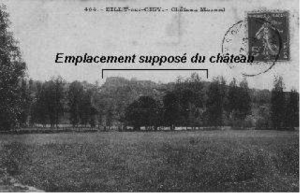Billy-sur-Oisy a une origine très ancienne comme en témoignent les nombreux silex taillés et tessons de poterie trouvés sur son territoire. Bourgade gauloise, ville forte au temps de la Gaule romaine, autrefois nommée Billiacum (du nom d'homme gaulois Billius), une voie romaine passe à proximité.
Au sud du village, la butte isolée du Château-Musard fut autrefois couronnée d’un château féodal
Cette terre appartenait originellement au Chapitre de la Cathédrale d’Auxerre, puis passa aux barons de Donzy devenus comtes de Nevers, qui en firent le siège d’une châtellenie, unie plus tard à celle de Corvol-L’Orgueilleux. Le comte Hervé rebâtit, en l’agrandissant, l’ancien château. Cette forteresse était imposante : elle mesurait 200 mètres de long sur 50 de large. Hervé et son épouse Mahaut de Courtenay, y firent de nombreux séjours. Mahaut y vint encore en 1250, quelques années avant sa mort, mais il fut délaissé ensuite.
En 1544, François Ier autorisa, par lettre patente, les habitants à créer foires et marchés et à entourer, à leurs frais, le village de murailles. Une tour en est l’unique vestige.

Pour l'histoire de Château-Musard, qui n'est plus aujourd'hui qu'un fantôme, laissons la parole à un érudit local, René Lussier (1864-1939) :
« Le touriste qui suit l'agréable route de Clamecy à Neuvy ne manque point de remarquer devant lui, dès qu'il quitte le joli site de Batilly, un monticule couronné de ruines. Ces vestiges de murailles presque parées d'un riche manteau de végétation sont les restes de Château Musard.
Ce château, bien que n'offrant que très peu d'intérêt historique, n'en a pas moins une certaine célébrité dans l'histoire locale et régionale. Née de la Rochelle le fait bâtir par César. Cette thèse n'a rien d'invraisemblable, attendu que cette forteresse commandait une voie romaine qui passait sous ses murs. Un point d'eau très important : la Fontaine de Grès, arrose le pied de ces glacis et pouvait suffire aux besoins de la garnison. De nombreuses monnaies et médailles, trouvées dans les environs, viennent appuyer cette supposition. Enfin, la situation agréable de ce lieu, à la naissance de la vallée du Champorin, a peut-être séduit le vainqueur des Gaules, mais elle a certainement inspiré la fantaisie des étymologistes qui l'ont appelé le "château des Muses". Pourtant ce nom ne prévalut point, puisque l'histoire dit Murat et non Musard.
Mais arrivons aux renseignements fournis par les documents historiques.
En 1212, Hervé de Donzy, comte de Nevers jeta les fondations de la construction où commença la restauration de la forteresse Murat. Mais cette construction était sur les fonds du Chapitre de Saint Etienne d'Auxerre. Les chanoines n'osaient attaquer que faiblement le puissant comte ; cependant d'après une sentence rendue à Billy, en août 1214, par Guillaume de Seignelay, évêque d'Auxerre, et son frère Manassés, évêque d'Orléans, le comte abandonna au Chapitre, à titre de dédommagement, tout ce qu'il possédait sur Oisy. Hervé dès lors, n'éprouva plus de difficultés dans ses travaux de restauration. Dès 1212, il avait agrandi son domaine de Billy par un échange avec Jehan de Toucy.
D'après les désirs du roi Philippe-Auguste, Hervé de Donzy avait épousé, en 1199, Mahaut ou Mathilde, fille de Pierre de Courtenay et d'Agnès, fille de Gui 1er, comte de Nevers.
Les époux s'embarquèrent pour la croisade à Gênes en 1218. Mais après l'assassinat de Pierre de Courtenay, qui venait d'être élu empereur de Constantinople, ils rentrèrent précipitamment en Nivernais pour vivre paisiblement dans leurs châteaux. Mahaut se plaisait beaucoup dans les châteaux situés sur les collines comme Druyes, Murat, Montenoison. Après avoir habité Montenoison, où elle passa le temps pascal en 1247, elle vint à Murat. C'est là qu'elle data le mardi d'après la mi-carême au mois de mars 1250, l'acte de mariage du chevalier Guy Breschard, sgr de Toury, avec Isabeau, fille de Geoffroy de Billy, de son vivant maréchal du Nivernais.
Au mois de juillet 1253, elle expédia de Murat la donation qu'elle fit aux écoliers d'Auxerre qu'on appelait "les Bons Enfants". Ce fut aussi de ce lieu qu'elle confirma l'acquisition que le Chapitre d'Auxerre avait faite des dîmes de Nannay. La fondation des deux chapelles dans le château de Nevers fut confirmée à Murat en 1256.
L'année suivante, Mahaut mourait à Coulanges sur Yonne, après y avoir fait sont testament par lequel elle demandait à être inhumée dans son abbaye de la Consolation de N-D, près de la Montcelle. Aujourd'hui encore, les restes de la grande comtesse reposent dans la terre de ce site enchanteur qu'est le Réconfort. La chapelle où tant de fois elle vint prier pour son aimé seigneur Hervé qui avait sa sépulture à Pontigny. Dans cet antique sanctuaire on pourrait reconnaître Mahaut portant l'image de l'abbaye qu'elle avait fondée. Hommage posthume de quelques admirateurs de Mahaut de Courtenay, l'une des plus grandes figurent de l'histoire du Nivernais.
Le mercredi 4 juin 1281, le comte de Nevers, Robert de Flandre, fit hommage au seigneur évêque d'Auxerre, Guillaume de Grez, pour le château de Murat et autres lieux. Ce même comte vint se réfugier dans son château Murat en 1290 et 1291, fuyant la colère du roi Philippe IV, contre lequel il avait guerroyé. L'évêque d'Auxerre, Pierre de Mornay, fait confirmer ses droits sur Murat en exigeant que le comte de Nevers, Louis de Flandre, lui prête foi et hommage (19 octobre 1296). Son successeur médiat, Pierre de Grez, fut moins heureux ; Louis de Nevers lui ayant refusé l'hommage en 1311. Pour ce refus, le comte se vit saisir Murat. Rentré en possession de son fief, il en fit la donation en novembre 1324, à son cousin, Alphonse d'Espagne, tout en s'en réservant la suzeraineté.
Dès le XVIème siècle, la forteresse Murat semble avoir perdu considérablement de sa puissance. Des aventuriers se rient de son quadrilatère de hautes murailles crénelées et de son double pont levis ; ils la pillent en 1554. Quelques années plus tard, en 1590, les Auxerrois, aidés par les gens d'Avallon et de Vézelay, peuvent mettre Billy à sac. La dernière mention du château remonte au 27 octobre 1660. Murat devait suivre le sort des autres châteaux du comte de Nevers ; il est abandonné par les successeurs d'Hervé et tombe en ruine.
Les abords et le sol du château sont vendus parcelle par parcelle, dès le commencement du XVIIIème siècle la vigne est plantée. Par la suite les habitant de Billy enlèveront les matériaux de bâtiments pour construire leurs maisons. Il ne reste plus de la fière forteresse, que le peuple dès 1743 désigne sous le nom de château Musard, que la gracieuse silhouette que l'on ne se lasse pas d'admirer en suivant la rue principale du bourg de Billy sur Oisy. »