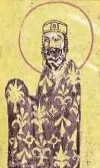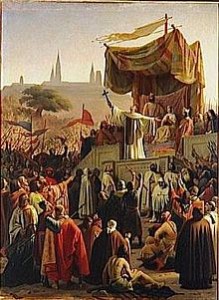(Illustration : Versailles, salles des croisades, époque de Louis-Philippe)
Les armoiries de Donzy figurent dans la cinquième Salle des Croisades du château de Versailles, en l’honneur de Geoffroy III, baron de Donzy et comte de Chalon, seigneur de Saint-Aignan et de Chatel-Censoir, qui prit part à cette épopée dès ses débuts. Il fut en effet parmi ceux qui répondirent à l’appel lancé à Clermont par le Pape Urbain II, le 27 novembre 1095, à l’origine de la première croisade (1096-1099).
Il s’agissait de rétablir l’accès des chrétiens à Jérusalem, que les Turcs, bientôt supplantés par les Fatimides, leur avaient interdit, et de répondre à l’appel de l’empereur byzantin Alexis Comnène.
Pour accomplir cette mission Geoffroy dut céder sa part du comté de Chalon à son oncle Savaric de Vergy, et mettre ainsi fin à ce lien ancestral avec sa dynastie bourguignonne.
Fut-il à la prise de Jérusalem en 1099, aux côtés de Godefroy de Bouillon ? Trouva-t-il la mort en Terre Sainte comme certains auteurs l’avancent, où prit-il effectivement l’habit de Cluny à son retour ? Avec quels vassaux du Donziais, chevaliers, écuyers et serviteurs, avait-il accompli cette expédition ? Les textes restent silencieux, mais Geoffroy avait en tout cas devancé son voisin et rival le comte de Nevers, Guillaume II, qui ne put rejoindre l’armée des croisés avec son frère Robert et quinze mille hommes dit-on, qu’en 1100, car il était auparavant mineur.
Les barons de Toucy, seigneurs de Puisaye, Ythier II et son frère Narjot faisaient partie de cette expédition. Il y trouvèrent la mort en 1100, les premiers d’une longue série : Ythier IV en 1147, Narjot II en 1192 à Acre, Ythier V en 1218 à Damiette, Jean en 1250 à Mansourah.
Pour la deuxième croisade, prêchée par Bernard de Clairvaux en 1146, les textes ne mentionnent pas la présence d’un baron de Donzy, pourtant si proche de Vézelay d’où le Saint avait parlé. Guillaume III de Nevers et son frère Robert, comte de Tonnerre, y figuraient bien quant à eux, ainsi que Pierre de France, sire de Courtenay, dont le fils fut plus tard comte de Nevers.
Geoffroy de Saint-Verain partit quant à lui en avant-garde de la troisième croisade en 1188 à la demande du comte de Nevers, après avoir octroyé des libéralités aux abbayes auxerroises de Reigny et de Crisenon, ainsi qu’à la Commanderie de Villemoison. Il entamait lui aussi une longue série : autour de Saint-Verain, les noms de Palestine donnés à différents lieux – comme Jérusalem – conservent la mémoire de cet engagement.
Trois des fils du baron de Donzy Hervé III prirent part à cette expédition et à la suivante. Ils y laissèrent la vie : Guillaume de Gien, l’aîné, qui fut baron trois ans avant de trouver la mort à Acre en 1191 ; Renaud de Montmirail, le cinquième, et Bernard, le dernier, tués tous deux en 1205 après le siège d’Andrinople.
Tout au long du XIIIème siècle enfin, les grands comtes de Nevers, barons de Donzy, s’illustrèrent en Terre Sainte : ainsi Archambaud IX de Bourbon, mort en 1249 à Chypre ; Eudes de Bourgogne, en 1269 à Acre ; ou encore Jean-Tristan de France, premier époux de Yolande de Bourgogne, fils de Saint-Louis, en 1270 à Damiette.
Peu mentionnés par les Chroniques, mais bien présents aux côtés des princes et des rois, les seigneurs de Donzy ont apporté leur contribution à cette vaste entreprise et la présence de l’écu d’azur aux pommes de pins d’or à Versailles, n’est que justice.