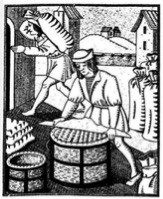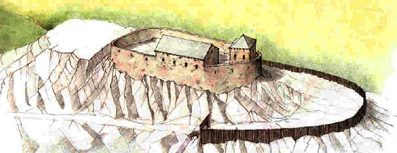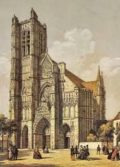(Illustration : les marais salants de Guérande)
Plusieurs possesseurs de petites seigneuries du Donziais exerçaient des fonctions auprès des Greniers à Sel de Cosne, Nevers ou Clamecy.
Ainsi Jehan Vaillant de Guélis, sgr de Brétignelles (XVème s.) ou Pierre Frappier, sgr de Dalinet étaient « Procureur(s) du roi au grenier à sel de Cosne » ; ou encore Jean-Jacques de Beaubois, sgr des Grandes-Maisons et du Liarnois (XVIIème), receveur du même grenier.
Un blason était attribué aux officiers du grenier de Cosne : « Tiercé en barre d’argent, de gueules et d’or. » Sans doute ces fonctions leur fournissaient-elles les moyens d’acquérir ou d’élargir leur assise foncière, antichambre de l’anoblissement auquel aspirait si ardemment la bourgeoisie urbaine. Il s’agissait là d’offices à caractère judiciaire et fiscal, autour du monopole royal du sel et de la perception de la gabelle. Ils étaient attribués par le roi (en pratique l’Intendant de la Généralité) et requerraient théoriquement une certaine compétence juridique.
Le grenier à sel était, comme son nom l’indique, un entrepôt, au cœur de la ville, où l’on conservait ce produit rare, indispensable à la vie des animaux et des hommes et seul moyen de conservation des poissons et viandes. Le pouvoir régalien en contrôlait totalement la distribution. Le sel était naturellement acheminé par la Loire depuis les zones de production, en particulier les salines de Guérande.
Du point de vue institutionnel les greniers étaient des tribunaux où se jugeaient, dans la limite d’un plafond assez bas, les contentieux de la « Gabelle ». Ils faisaient vivre, outre leurs officiers et employés, des kyrielles d’avocat fiscaux et autres « praticiens » des campagnes, dont nos fiches donnent de nombreux exemples. Pour un enjeu fiscal supérieur ou en appel, la Cour des Aides – celle de Paris en l’occurrence pour notre région – était compétente.
En Donziais, seul le grenier à sel de Cosne est officiellement répertorié dans les sources, avec ceux de Nevers, La Charité, Clamecy, Château-Chinon, Luzy, Decize et Moulins-Engilbert en Nivernais, dont certains n’étaient sans doute que des dépôts. Les paroisses de l’ancienne baronnie en relevaient. Il fonctionna de 1473 à 1750, dans des bâtiments situés près de la chapelle du palais épiscopal dite « N.-D. de Galles », fondée au IXème siècle et reconstruite au XVème, qui abrite aujourd’hui un temple maçonnique.
Un grenier est mentionné à Donzy, « au coin de la rue des Bancs et de la place du Marché » et figure sur le plan reconstitué de la ville d’Amédée Jullien, mais il s’agissait sans doute d’une simple annexe, à laquelle une activité judiciaire ne paraît pas avoir été attachée. Il n’existe plus.
Celui de la Charité-sur-Loire, établi dans une maison construite par les moines au XIIème siècle et attribuée à cet office en 1690, est délabré mais toujours visible. Celui de Clamecy, superbe bâtisse du XVème siècle, a disparu.
L’histoire des greniers à sel, créés en 1342 par le roi Philippe VI de Valois – qui entendait se doter des moyens de ses ambitions – est étroitement liée à celle de la gabelle, un impôt indirect qui allait représenter pour le trésor royal une importante ressource. Sa perception fut affermée dès le XVIème siècle, cantonnant les officiers des greniers à une fonction strictement judiciaire, alors que des employés des Fermes se chargeaient de la commercialisation. Des réorganisations successives conduisirent à une Ferme Générale unique au XVIIème siècle.
Dans les pays dits de « Grande Gabelle », comme c’était le cas de la Généralité d’Orléans et de toute la moitié nord du pays (sauf la Bretagne) les greniers dits « de vente volontaire » imposaient aux assujettis d’acheter chaque année au moins un minot de sel d’une contenance de 72 litres (réputés peser 48,9 kg) pour quatorze personnes de plus de huit ans. On parlait de « vente volontaire » parce que les contribuables pouvaient acheter leur sel au moment qui leur convenait, et que les pauvres n’étaient pas tenus à l’achat. Liberté oui, mais dans certaines limites…
La Révolution supprima ce monopole et la gabelle, qui toutefois ressuscita sous l’Empire et perdura avec des éclipses jusqu’à la seconde guerre mondiale. L’opprobre populaire se fixa donc longtemps sur les « gabelous », une corporation honnie des contrebandiers en puissance de nos campagnes.
Les greniers à sel, institutions vénérables et craintes de la monarchie absolue, avaient tenu une place importante dans la vie des populations du moyen-âge finissant à l’époque moderne. Des noms de rues rappellent souvent leur mémoire au cœur des vielles cités.
Nous serions intéressés par toute information ou source concernant le Grenier de Donzy…